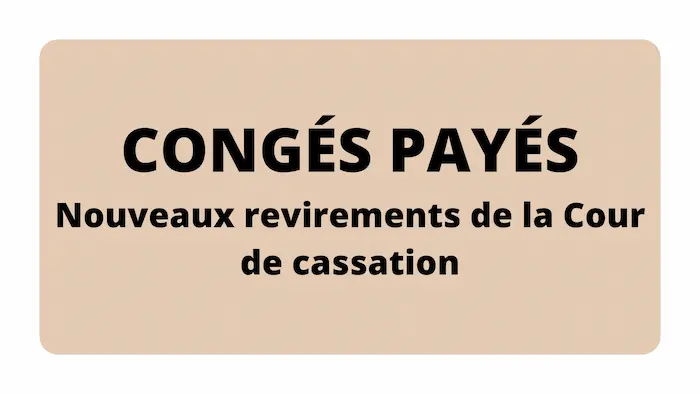
Deux décisions majeures du 10 septembre 2025 viennent une nouvelle fois bouleverser les règles en matière de congés payés en instaurant un droit à report des congés payés en cas de maladie pendant les vacances et la prise en compte des congés payés dans le calcul des heures supplémentaires.
Le droit au report reconnu lorsque le salarié tombe malade pendant ses congés
Pendant longtemps, un salarié qui tombait malade pendant ses vacances n’avait tout simplement pas droit à un report. C’était la position de la Cour de cassation depuis 1996 : une fois les congés posés, tant pis si une grippe venait tout gâcher. Le salarié ne pouvait pas récupérer ces jours, même s’il était cloué au lit.

Mais à l’échelle européenne, le droit est tout autre : depuis 2009, la CJUE rappelle que les finalités des deux régimes sont différentes :
- Le congé payé sert à se reposer et profiter de son temps libre ;
- Le congé maladie permet de se soigner.
Donc si un salarié tombe malade pendant ses vacances, il ne profite pas réellement de son repos. Il doit donc pouvoir reporter ses congés.
En France, cette position européenne a mis du temps à s’imposer, bien qu’une première amorce avait déjà été engagée avec la décision, en ce sens, de la Cour d’appel de Versailles en 2022 (RG n° 19/03230) et la loi du 22 avril 2024 qui a introduit la possibilité de reporter les congés acquis lorsque le salarié est dans l’impossibilité de les prendre en raison d’un arrêt maladie ou accident, conformément au droit européen.
Le revirement était inévitable suite à la procédure d’infraction lancée par la Commission européenne contre la France en juin 2025 qui l’a contraint à se conformer au droit communautaire dans un délai de 2 mois à compter du 18 juin 2025.
Résultat : La Cour de cassation a officiellement opéré son revirement le 10 septembre 2025 (Cass. soc., n° 23-23.732). Désormais, un salarié malade pendant ses congés pourra demander leur report, à condition de notifier son arrêt à l’employeur.
Ce que l’on sait :
- Le salarié doit prévenir son employeur de son arrêt.
- Il doit transmettre son arrêt de travail dans les délais habituels (en principe 48 h), sauf accord collectif plus strict.
Ce qui reste flou :
- La Cour ne dit pas quel délai exact le salarié doit respecter.
- Est-ce que ce droit au report sera rétroactif ? Pour des congés déjà « perdus » ?
- Quelle prescription s’appliquera pour faire valoir ce droit ?
- Comment paie-t-on cette période ? En principe comme un arrêt maladie classique : IJSS, maintien de salaire, jours de carence…
Exemple concret :
Paul part en congés du 5 au 16 août. Le 6 août, il est hospitalisé. Il prévient son employeur et envoie son arrêt. Avec la nouvelle jurisprudence, les jours de congé non réellement pris pourront être reportés. Avant cet arrêt, ces jours étaient tout simplement perdus.
À savoir également : Nouveau formulaire d’arrêt de travail 2025, ce qui change dès septembre.
Congés payés et heures sup : le décompte change aussi
Avant : si un salarié prenait des congés payés pendant la semaine, ces jours n’étaient pas comptés dans le calcul des heures supplémentaires. Seules les heures réellement travaillées comptaient (jurisprudence constante depuis 2004).

La Cour de cassation vient d’y mettre fin dans un arrêt du 10 septembre 2025 (Cass. soc., n° 23-14.455), parce que cette règle française est contraire à l’article 7 de la directive 2003/88/CE et à l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Désormais, les jours de congés payés doivent être pris en compte dans le calcul hebdomadaire des heures supplémentaires, dès lors que ce calcul se fait à la semaine.
Exemple concret :
Emma est en congé lundi et mardi. Elle travaille ensuite 8,5 heures par jour du mercredi au vendredi.
- Avant : 8,5 x 3 = 25,5 heures → pas d’heures sup.
- Maintenant : on ajoute 7 h + 7 h (congés lundi/mardi) → 39,5 h → Emma a 4,5 heures supplémentaires à majorer !
Ce qu’on ne sait pas encore :
- Quid des décomptes mensuels ou annuels ?
- Est-ce que cela concerne toutes les semaines de congés, y compris la 5e semaine française, ou seulement les 4 garanties par le droit européen ?
Ces deux arrêts viennent remettre la France en conformité avec le droit européen, mais laissent encore des zones d’ombre : rétroactivité, prescription, modalités de notification, et traitement en paie.
À lire également : Bonus-malus chômage 2026, ce qui change dès 2026 et ce qu’il faut anticiper .
Ce qu’il faut retenir pour les RH et les employeurs :
Les récentes évolutions en matière de droit du travail appellent une vigilance particulière de la part des employeurs et des responsables RH. Pour rester en conformité et éviter les litiges, il est essentiel de garder à l’esprit les points suivants :
- Anticipez les demandes de report de congés en cas d’arrêt maladie.
- Mettez à jour vos pratiques de calcul des heures supplémentaires.
- Restez en veille sur les futurs éclaircissements (textes ou jurisprudence) sur les points non tranchés.
En somme, ces ajustements nécessitent une organisation proactive et une veille juridique continue. Ils constituent autant d’occasions de renforcer les pratiques RH et d’assurer une gestion sociale sécurisée pour l’entreprise.
À découvrir également :

